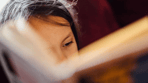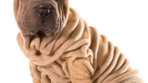« LE RÈGNE ANIMAL », UN FILM HYBRIDE, COMME NOTRE ÉPOQUE.
Ce samedi 7 octobre, nous avons vu - avec mon très cher D. - le long-métrage « Le Règne animal » de Thomas Cailley (qui avait réalisé « Les Combattants », sorti en 2014, avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs ») qui met en scène des personnages incarnés par Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier et Paul Kircher.


[Attention, ce billet a moult morceaux de spoiler dedans ; reviendez quand vous aurez vu le film.]
Commençons en ronchonnant (sinon ce ne serait pas ouam) : je ne suis pas d’accord avec les critiques qui ont écrit, entre autres, que ce film « est un blockbuster d’auteur » (qu’est-ce que c’est que ce délire encore ?!), « est à la croisée du fantastique (dans le sens du genre) et de la comédie », « détonne par sa maîtrise, son originalité, cette faculté à mêler les genres, sans rien qui pose ou qui pèse », donne à voir « un angle résolument apocalyptique et fantastique (encore !) ».
Le mot « fantastique » est donc employé dans pas mal de critiques de ce film, à la fois comme complément et synonyme de celui de « merveilleux ». « On » va peut-être (encore) penser/dire que je suis une « grammar nazie » (j’avais halluciné en découvrant cette appellation), mais ce n’est pas ça qui me fera renoncer à écrire mes petites mises au point.
Le cinéma fantastique tire son origine de la littérature du même genre où le Fantastique se distingue du Merveilleux par L’HÉSITATION qu'il produit entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible et, parfois, entre le logique et l'illogique. Le Merveilleux, lui fait appel au surnaturel dans lequel, une fois acceptés les présupposés d'un monde magique (par le Lecteur ; les personnages, eux, vivent leur monde sans étonnement), les choses se déroulent comme si tout était normal. Certes le monde du « Règne animal » n’est pas magique, mais il n’y a aucune hésitation quant à la nature « réelle » des événements auxquels sont confrontés les personnages. D’autre part, le film n’est pas plus « apocalyptique » (qui évoque la fin du monde, de terribles catastrophes) que notre réalité, même si en effet la société qu’il donne à voir est confrontée à une maladie à laquelle nous n’avons jamais eu droit (métaphoriquement, oui : cf les changements cognitifs profonds inhérents à l’utilisation massive et anarchique d’Internet). Pour ce qui est de la « Comédie », hum, il est vrai qu’on entend dans « Le Règne animal » quelques répliques qui m’auraient fait bien marrer si elles avaient été prononcées dans un film cumulant moins de genres. C’est l’un des défauts de ce long-métrage (pour D. et moi).
Je ne sais plus quel critique a écrit que le film dont il est question ici est un « conte écolo, conte fantastique, conte politique, conte adolescent, conte intimiste : “Le Règne animal” est un peu tout ça. » Pour le coup, je suis d’accord : c’est un conte (mais ni fantastique ni familial comme le disent les Médias, moyen moins pour les moins de 14/15 ans, il y a trois ou quatre scènes à la Cronenberg), un conte ne serait-ce que parce que, comme dans beaucoup d’entre eux, the mother is dead (bon, en vrai non, mais sa métamorphose en cours l’a rendue dangereuse pour son rejeton et l’en a éloignée, de force. Le gosse, lui, la considère comme morte ; on comprend bien pourquoi #LaPeurEtLaHonte). J’ajouterais à « conte écolo, politique, adolescent, intimiste », conte sur la parentalité (quand elle n’a pas peur de ses petits), sur l’amitié, sur… en fait beaucoup trop de thématiques. C’est là où le film joue contre lui-même et ce qui a fait qu’avec D., nous sommes sortis de la salle un poil frustrés et se questionnant sur le pourquoi du comment les deux scénaristes avaient décidé de traiter autant de sujets dans un même film, sacrifiant donc la possibilité de pousser jusqu’au bout ceux qui étaient les plus urgemment à mettre en lumière (exigence des producteurs ?), particulièrement celui de la métamorphose. Eugène Ionesco l’avait compris en son temps avec sa pièce de Théâtre « Rhinocéros » (1959).
« Le Règne animal » a pour cœur de propos celle d’êtres humains non pas en une seule espèce d’animal mais en plusieurs, toutes sauvages (#VersionÉcoloDesXmen). Thomas Cailley et Pauline Munier ont choisi de mettre sur le devant nos yeux une femme (mère), des enfants filles (dont une est juste mentionnée) et un qui semble être un garçon (qui devient un pangolin, tiens tiens), un étranger (qui devient un oiseau…) et un adolescent, Émile (dont la métamorphose se révèle sous nos yeux) ; pas d’individu simplement homme « lambda » donc. Il y a bien une scène dans la forêt au cours de laquelle on aperçoit une multitude d’humains dont la transformation est plus ou moins avancée, mais leurs genre/sexe/âge reste flous. En revanche, les individus « hommes » sont sur-représentés parmi ceux qui ne sont pas vraiment gentils-gentils envers « les bestioles », sauf le personnage de François (Romain Duris, cuisinier de profession, contraint au déclassement pour « suivre » sa femme mutante), père d’Émile, magnifique d’engagement maladroit, mais constant dans sa volonté de tenter de maîtriser les digues qui se brisent autour de lui. Parmi les humaines qui, elles, n’ont pas peur des « créatures », on trouve une maghrébine de plus de cinquante ans et commis de cuisine, une gendarmette empathique subissant les quolibets de ses relous de collègues mâles (Adèle Exarchopoulos, personnage dont le seul intérêt est d’être une rareté dans son milieu professionnel, tant par son genre que par son attitude face à l’Autre) et une lycéenne TDAH (les deux dernières remplissant aussi la fonction d’amoureuses, potentielle pour la première), bref non seulement des femmes mais aussi des malmenées.
Je reviens sur la nature sauvage des animaux que deviennent les personnes ayant contracté la maladie qui frappe les êtres humains de ce monde, en tous points identique au nôtre en dehors de ce fait. Pourchassés, où vont-ils se réfugier ? Eh bien dans une forêt de pins (aaaah, les Landes) emplie de silence puisque vidée de sa biodiversité (François explique à Émile, avec regret, lors d’une recherche nocturne que c’est à cause de la monoculture, hérésie agricole). Des humains devenus des animaux « exotiques » repeuplant une nature rendue majoritairement stérile par l’activité humaine, une sorte d’arche de Noé à l’air libre… La boucle est bouclée et c’est l’une des belles idées du film. Mais, hélas, la narration ne s’y attarde pas assez longtemps pour que tout le monde puisse s’en saisir pleinement.
Notons, c’est important, qu’l y a des moments vraiment très réussis dans « Le Règne animal » : la séquence que j’appellerais « Pierre Bachelet », celle à qui je donnerais l’appellation de « Vas-y, fais donc un tour de vélo ! », celle qui pourrait s’intituler « Remake de la séquence du tronc dans “Dirty dancing” », celle qui ne peut pas se nommer autrement que « Tentacules et écailles au supermarché » ou encore celle possiblement dite de « Une maman se souvient », filmée comme un rêve. Bouleversante.
Cela étant, une séquence m’a bien saoulée : celle de la mort de Fix, l’étranger, mi-homme mi-oiseau (qui apprend à voler grâce à l’amitié que lui offre Émile). Je comprends bien ce que les scénaristes ont voulu dire par cet assassinat (référence sans nul doute à la mort, dans l’indifférence quasi générale, des migrants qui tentent de rejoindre des mondes plus apaisés - pour l’instant - que les leurs), mais en ce qui me concerne (alors que j’ai pourtant la larme facile), je n’y ai vu que les ficelles, que dis-je, les cordes, installées pour actionner la poulie « chialade » chez le Spectateur. Et puis, cette séquence tombe trop lourdement dans le timing du film, comme ce bel homme-oiseau touché en plein vol par une balle et s’écrasant rudement au milieu de la forêt.
En revanche, pour rester dans le volet « émotionnel », le film m’a cueillie lors de sa dernière scène et quelques larmes ont coulé hors de mes yeux (heureusement pas maquillés cette fin d’après-midi-là). Je le précise d’autant plus que j’étais dans un état d’indécision quant à ce que je venais de voir durant l’heure et 55 minutes précédente (le film dure 2h05) incluant des séquences lors desquelles je me suis ennuyée, voire agacée et d’autres qui, vous l’avez lu précédemment, m’ont emportée, charmée, bref beaucoup plu. Ces quelques larmes ont été l’expression autant de la réussite de cette dernière scène que de ce à quoi elle m’a renvoyée dans ma vie personnelle : le parent contraint de se rendre compte qu’il est allé au bout de ce qu’il était en mesure de faire pour accompagner la personne qu’il voyait jusqu’alors comme un enfant (“son” : beaucoup de parents - moi incluse - considèrent, presque malgré eux, que leurs petits leur appartiennent), le parent qui comprend en un instant que le moment est venu d’ouvrir ses bras protecteurs – et donc aussi étouffants – pour faire naître une seconde fois au monde l’individu issu de lui (et d’un(e) autre). Ce parent qui sait bien que sa vie et celle de son « presque devenu adulte » ne peuvent plus durablement être communes sans que cela ne devienne dangereux (ici au sens propre) pour eux deux, ce parent qui a compris que celui qui était jusqu’alors « en dessous », va se mettre à faire ses premiers pas « à ses côtés », qu’il doit avancer à présent, par ses propres moyens, le reste du chemin vers lui-même. Eh bien ce parent, incarné ici par Romain Duris, inquiet mais déterminé m’a bouleversée parce que ce parent c’est moi, pile poil (pas que hein, j’en connais d’autres dans ce cas, et qui ont/vont versé/verser leurs larmichettes à ce moment-là).
Cette idée de l’inconnu à propos de ce(ux) que vont devenir nos adolescents lorsqu’ils quittent « la maison » est subtilement dit dans une réplique prononcée par le personnage de François, une question qu’il pose à son fils alors qu’il roule à tout berzingue pour échapper aux forces de l’ordre et protéger ainsi, une dernière fois, son garçon-mutant : « Tu sais à quelle vitesse peuvent courir un renard ou un loup ? » « Un renard ou un loup » parce que, à ce stade de la métamorphose d’Émile, si François a compris qu’il sera un canidé, il ne voit pas (encore) exactement lequel ; le spectateur, lui, le sait puisqu’il a vu et entendu le hurlement de nuit d’Émile (#LoupLoup). L’acceptation de François de ce qui arrive à Émile est totale, et sublime. Cette fin de film m’a fait penser à celle de « Mommy » de Xavier Dolan (2014) : un jeune qui court dans et vers la lumière. Mais, si Steve court dans un couloir, visiblement vers une mort qu’il juge être le seul moyen de se libérer de lui-même (et de sa mère, touchante de défaillances), Émile court, lui, dans la nature, à l’air libre, le visage enfin débarrassé des douleurs de l’adolescence, porté par l’amour, certes imparfait et tâtonnant, d’un père qu’on imagine n’avoir jamais cessé de lui témoigner tout au long de leur vie commune.
Je reverrai ce film qui, s’il n’est pas « le chef-d’œuvre » décrété par le magazine « Première » (et d’autres) ni aussi réussi que ce qu’il aurait pu (dû ?) être, n’en demeure pas moins profondément intéressant. D’abord parce qu’il est à l’image de notre époque où tout est amalgamé à tout et examiné dans un tempo décidément trop rapide. Un grand tout, hybride, sans limites de Temps et d’Espace, un grand tout qui ne prend pas (ou à qui « on » ne permet pas ?) la peine de s’arrêter, de tourner autour, d’observer en silence (au plus en chuchotant), de réfléchir et enfin d’analyser pour espérer se métamorphoser, au fil des années, en êtres humains dignes de ce nom, état qui a peut-être plus de points communs avec les animaux sauvages que ce que l’on aime à penser.
POINT ACTEURS-TRICES.
Romain Duris : il a su rendre le personnage de François intense, touchant, sorte d'incarnation de la paternité dite moderne (mélange subtil de distance et de proximité avec son rejeton, le tout dans un amour tâtonnant, oscillant entre accès d'autorité et volonté aimante d'être compréhensif. Tellement bien vu.)
Paul Kircher (nepo-baby puisque fils du comédien de Théâtre Jérôme Kircher et de la comédienne Irène Jacob ; sauf que lui, contrairement à d'autres, il en a sous le pied en tant que comédien) : sa diction étrange (qu'il a aussi dans la vraie vie) et son physique qui l'est tout autant, servent parfaitement le personnage d'Émile. C'est un rôle difficile qu'il a eu à jouer, à la fois cérébral et très physique, et il s'en sort haut la main.
Adèle Exarchopoulos : je me demande si dans le scénario originel, le personnage de Julia n'avait pas plus de scènes. Parce que là, vraiment, c'est typiquement le personnage qui, si on le dégage du film, celui-ci n'en souffrirait pas une seconde. Dommage parce que c'est une super actrice, ici comme souvent.
Tom Mercier : acteur israëlien que je ne connaissais pas. Il a fait du personnage de Fix un être tout en douleur rageuse qui voit son humanité s'envoler (à la fois partir et embellir) sous nos yeux (il m'a fait penser au personnage de fantôme bien vénère que Patrick Swayze, devenu fantôme, rencontre dans le métro et qui lui explique comment agir sur le monde des vivants dans "Ghost", 1990.)